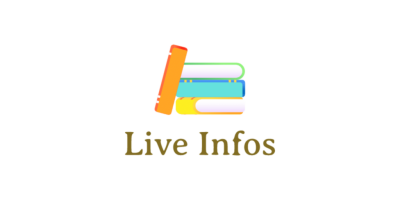En 2024, l’industrie musicale française subira une transformation majeure avec l’introduction d’une « taxe streaming ». Certes, le ministère de la Culture a confirmé que les revenus des plateformes de streaming seront soumis à cette mesure. Cette initiative a alors provoqué des réactions mitigées, notamment l’indignation de Spotify et Deezer. De plus, certains prônent une contribution volontaire. Par contre, d’autres estiment qu’une taxe obligatoire est nécessaire pour soutenir la diversité culturelle et le secteur musical en France. Voici un article qui se focalise sur cette « taxe streaming ».
Incertitude autour de la « Taxe Streaming »
Le secteur musical français se retrouve à un tournant. La perspective d’une taxe sur le streaming, prévue dans le projet de loi de finances 2024, suffit à alimenter toutes les conversations. Pourtant, une part d’ombre persiste : le taux exact et les modalités d’application restent en suspens. Résultat, les plateformes numériques et l’ensemble des acteurs attendent, parfois dans l’inquiétude, de connaître l’impact réel sur leur rentabilité, mais aussi sur la rémunération des artistes et la santé des labels.
En avril, le sénateur Julien Bargeton a remis un rapport au ministère de la Culture. Il y plaidait pour un prélèvement de 1,75 % sur le chiffre d’affaires des plateformes, évoquant un rendement potentiel de 20 millions d’euros par an. Mais ces montants relèvent encore de l’estimation : rien n’a été gravé dans le marbre, et tous guettent des données chiffrées plus précises qui tardent à arriver.
Pour celles et ceux qui souhaitent élargir leur veille sur l’industrie musicale et la culture, d’autres actualités sont à retrouver ici : https://www.fimina-mag.fr.
L’actualité des débats sur la contribution volontaire
Les discussions sur la taxe prennent une tournure inattendue depuis l’annonce commune de plusieurs géants du numérique. Voici les principaux concernés :
- Apple
- Deezer
- Meta
- Spotify
- TikTok
- YouTube
Ces entreprises s’engagent à verser, de leur propre chef, une contribution pour soutenir les missions du Centre national de la musique. Elles visent un montant supérieur à 14 millions d’euros dès l’année 2025, une somme loin d’être négligeable dans le paysage culturel français.
Pourtant, l’idée d’une participation fondée sur le volontariat divise. Pascal Nègre, président du label 6&7, met en garde : selon lui, seule une taxe, contrôlée par l’État, garantirait une véritable indépendance aux politiques musicales du pays. Miser sur la bonne volonté des plateformes reviendrait à leur donner un pouvoir disproportionné dans la définition des grandes orientations culturelles. Pour défendre la création musicale française, il estime qu’il faut un cadre solide, et non une simple promesse de versement à la carte.
Adoption de la taxe par le Sénat
En novembre, le Sénat a pris sa décision. Les parlementaires ont adopté la mise en place d’une taxe sur le streaming musical : toutes les entreprises réalisant plus de 400 millions d’euros de chiffre d’affaires devront s’acquitter d’un taux de 1,75 %. Ce choix a été accueilli favorablement par plusieurs associations du secteur, qui y voient un système stable, loin de la logique aléatoire du volontariat.
Réactions variées des plateformes majeures
Chez les plateformes, la pilule passe mal. Spotify et Deezer, en tête, dénoncent ce nouvel impôt qui, selon eux, risque de fragiliser leur modèle économique. Leur inquiétude : perdre en compétitivité face à des rivaux internationaux qui ne sont pas soumis à la même contrainte. Ces arguments font écho à une réalité du marché : la concurrence mondiale sur le streaming musical est plus vive que jamais, et la moindre différence de traitement peut peser lourd.
La suite reste à écrire. Entre la volonté de soutenir la diversité culturelle et la nécessité de rester attractif sur le marché mondial, la France avance sur une ligne fine, parfois instable. Cette nouvelle taxe dessinera-t-elle un paysage plus juste ou marquera-t-elle le début d’une série de tensions inédites entre plateformes et institutions ? La réponse se joue sans filet, au rythme d’une industrie qui n’a jamais vraiment cessé de se réinventer.