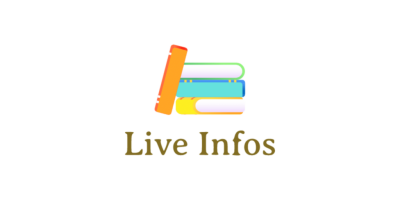L’année 1967 marque l’apparition de la mini-jupe sur les podiums parisiens, alors même que certaines écoles britanniques en interdisent encore le port. Les créateurs exploitent des matières synthétiques inédites, malgré la prédominance du coton et de la laine dans les garde-robes traditionnelles.
Les codes vestimentaires établis vacillent sous l’influence de la jeunesse, tandis que les grands noms de la haute couture s’inspirent ouvertement de la rue. Les frontières entre style populaire et luxe se brouillent, redéfinissant les standards du vêtement au quotidien.
1967, une année charnière pour la mode et les mentalités
Du pavillon de l’Expo 67 à Montréal jusqu’aux ateliers de création européens, la mode prend un virage inédit. Sur les rives du Saint-Laurent, l’innovation technique rime avec une révolution des mentalités : designers et artistes captent les signaux faibles d’une époque en pleine mutation. Le Musée McCord consacre une exposition à cette effervescence, MODE EXPO 67, véritable vitrine de la modernité canadienne où Michel Robichaud et Jacques de Montjoye côtoient d’autres créateurs en quête d’audace.
Au cœur de cette agitation, la robe en papier signée Eleanor Ellis, croquée avec malice par Robert LaPalme, s’impose comme un manifeste. Elle remet en question la notion même de vêtement pérenne et propulse la mode jetable sur le devant de la scène. Les uniformes d’hôtesses, conçus par Robichaud pour l’exposition universelle et par Serge & Réal pour le Pavillon du Québec, deviennent des symboles d’un Canada ouvert, prêt à se présenter comme un acteur de la modernité mondiale.
Voici les marqueurs qui illustrent la dynamique de cette année hors-norme :
- Le design devient synonyme d’émancipation et d’affirmation personnelle
- La culture jeunesse du baby-boom insuffle un vent de nouveauté sur la création populaire
- À la Place des Arts, l’EXPO 67 LIVE accueille l’ONF et diffuse des images et histoires inédites qui résonnent dans tout le pays
La mode de 1967 ne se résume pas à une affaire de style ou de coupe. Elle incarne la volonté d’une génération, née après la guerre, de s’affranchir des carcans et de réinventer le vêtement comme un acte de liberté. Paris, Londres, Montréal : partout, l’imagination s’impose comme la règle, transformant chaque pièce en terrain d’expérimentation visuelle et culturelle.
Qu’est-ce qui rend les silhouettes de 1967 si reconnaissables ?
Impossible d’évoquer 1967 sans mentionner la mini-jupe. Symbole d’une jeunesse qui veut tout, tout de suite, elle surgit à Londres sous l’impulsion de Mary Quant. Dans son sillage, Patou, Yves Saint Laurent ou Pierre Cardin proposent des robes trapèzes, des tailleurs aux lignes franches, des coupes nettes qui claquent comme des manifestes. Les ourlets raccourcissent, les jambes s’affichent. L’après-guerre et ses corsets semblent bien loin, la mode fait place à l’énergie, à la liberté de mouvement, à une modernité palpable.
Balenciaga avait bousculé le classicisme avec sa robe sac ; Mary Quant parachève la rupture, propulsant la mini-jupe dans la rue. Les matières suivent : PVC, polyester, acrylique, tissus techniques, tout s’invite dans le vestiaire et bouscule les habitudes. À New York, Norman Norell, à Paris, Ungaro, Jean Muir ou John Bates, tous défendent un prêt-à-porter libéré des conventions. Betsy Johnson, avec sa boutique Paraphernalia, incarne l’effervescence new-yorkaise.
Quelques éléments-clés résument l’allure de cette année charnière :
- Des couleurs franches et des contrastes appuyés
- Épaules marquées, taille dessinée, gestion savante des volumes
- Robes courtes, lignes géométriques, influence pop omniprésente
- Accessoires qui claquent : bottes blanches, lunettes surdimensionnées
En 1967, la rue dicte la tendance, les créateurs emboîtent le pas. Chaque silhouette devient déclaration : le vêtement sort de son rôle d’ornement pour revendiquer une place dans la modernité et affirmer l’appartenance à la nouvelle culture populaire.
Icônes et créateurs : qui ont marqué le style de l’année ?
Cette année-là, une poignée de noms s’imposent comme des références. La jeunesse prend le devant de la scène, incarnée par Twiggy, Jean Shrimpton ou Penelope Tree. Leur silhouette, androgyne et aérienne, séduit une génération en quête de renouveau. Mary Quant, à Londres, impose la mini-jupe et fait de la boutique Biba le haut lieu des Mods londoniens, amateurs de couleurs franches et de coupes nettes.
La coiffure n’est pas en reste : Vidal Sassoon impose ses coupes courtes graphiques, qui deviennent la signature de Peggy Moffit, Nancy Kwan ou Mia Farrow. Outre-Atlantique, Jackie Kennedy reste une icône, toujours élégante en tailleur pastel signé Oleg Cassini. Paris conserve sa place centrale sur la carte mondiale de la couture, tout en s’ouvrant aux influences venues d’ailleurs.
À New York, Diana Vreeland, rédactrice en chef de Vogue, forge le terme Youthquake pour décrire la secousse créative de la décennie. Edie Sedgwick, muse d’Andy Warhol, incarne la démesure et l’audace de l’époque. Chaque figure, chaque créateur, repousse les frontières du style et inscrit 1967 dans la mémoire collective de la mode contemporaine.
Comment s’inspirer aujourd’hui de l’audace des années 60 ?
Le souffle de 1967 continue d’alimenter la création contemporaine. Yves Saint Laurent, en ouvrant sa première boutique de prêt-à-porter, donne le ton : le style s’ouvre au plus grand nombre. Les matières synthétiques, les coupes franches, l’emprunt du vestiaire masculin par le féminin, tout cela résonne encore dans les collections d’aujourd’hui. Mary Quant et sa mini-jupe restent des figures tutélaires pour bien des créateurs.
L’esprit Old money, aujourd’hui incarné par Ralph Lauren et Polo, propose une élégance sans ostentation, souci du détail et belles matières. Barbour, quant à elle, rappelle l’attachement à l’authenticité britannique, version chic et campagne. La tension entre Old money et New money continue d’inspirer les designers actuels : classicisme d’un côté, audace graphique de l’autre, deux pôles qui nourrissent l’imaginaire mode.
Pour renouveler les silhouettes, il suffit de plonger dans la créativité effervescente de l’époque : expositions comme MODE EXPO 67 au Musée McCord de Montréal, uniformes d’hôtesses signés Michel Robichaud ou Serge & Réal, robes conceptuelles de Jacques de Montjoye et Eleanor Ellis. Ungaro, Jean Muir et John Bates, pionniers du prêt-à-porter, ont ouvert la voie à une mode accessible et inventive. S’inspirer de 1967, c’est mêler héritage et expérimentation, liberté de ton et respect du patrimoine.
Au fond, 1967 laisse un sillage éclatant : chaque vêtement, chaque couleur ou accessoire a le pouvoir de transformer le quotidien, de bousculer le regard, de réaffirmer qu’oser reste la plus belle façon d’être moderne.