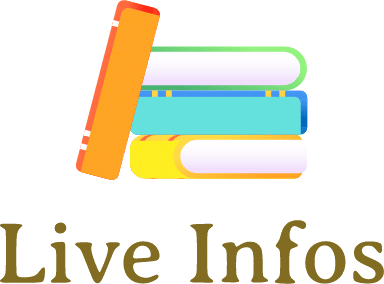2,3 milliards d’euros pour moins de 10 kilomètres : la démesure, chiffrée noir sur blanc, ne laisse aucune place à l’interprétation. Cette somme catapulte ce projet dans la stratosphère des opérations routières les plus coûteuses jamais entreprises, toutes catégories confondues.
Dérapages financiers, batailles judiciaires, opposition farouche de toutes parts : le chantier a été tout sauf un long fleuve tranquille. L’économie locale, loin de se mettre au diapason, reste partagée entre promesses de retombées et doutes persistants quant à la rentabilité d’un tel projet sur le long terme.
Plan de l'article
Où se trouve la route la plus chère du monde ?
La route la plus chère du monde ne serpente ni entre les tours de Dubaï, ni sous les néons de Singapour. Elle s’étire le long de l’océan Indien, sur l’île de La Réunion, ce territoire français posé à des milliers de kilomètres de la métropole. La Nouvelle route du Littoral (NRL) relie Saint-Denis à La Possession, dominante, défiant les vagues sur une succession de viaducs et de digues. On ne parle pas ici d’une simple route : c’est un ouvrage d’art posé sur la mer, où chaque mètre carré d’asphalte a coûté une fortune.
La prouesse technique ne fait pas oublier le coût pharaonique de la NRL. Avec près de 2 milliards d’euros pour 12,3 kilomètres au total, dont seulement huit praticables aujourd’hui, le prix au kilomètre dépasse les 167 millions d’euros. À titre de repère, une autoroute classique en rase campagne coûte entre 5 et 7 millions d’euros le kilomètre. Même le spectaculaire viaduc de Millau, souvent cité en exemple, reste en retrait.
Ce tracé suit la côte nord-ouest de la Réunion pour répondre à une menace bien réelle : la route historique, accrochée à la falaise, subissait éboulements et inondations à répétition. Désormais, 60 000 à 80 000 véhicules empruntent chaque jour cet axe vital, indispensable pour relier les principaux pôles urbains et économiques de l’île.
Piloté par le Conseil régional et largement soutenu par l’État, ce chantier gigantesque a mobilisé les géants du BTP français, Bouygues et Vinci, mais aussi une galaxie de sous-traitants réunionnais. Depuis 2015, la NRL bouleverse le paysage, et pas seulement au sens propre : écologie, politique, finances publiques, tout y passe. Pas étonnant que le projet déchaîne autant de passions que de critiques.
Un chantier hors normes : coût, tracé et financement
Symbole d’une ambition sans limite, la nouvelle route du littoral s’impose comme un laboratoire du génie civil moderne. Oser poser une route sur l’océan Indien, affronter houles, cyclones et falaises instables : la prouesse force le respect. Mais cette audace se paie cher : quasi 2 milliards d’euros pour 12,3 kilomètres, soit 167 millions au kilomètre, un record absolu. Les infrastructures routières classiques semblent à des années-lumière : 5 à 7 millions au kilomètre en plaine, et même le viaduc de Millau n’atteint pas de tels sommets.
Le choix du tracé, conjuguant viaducs et digues, s’est imposé comme une évidence face aux risques d’éboulements et aux assauts de l’océan. Aujourd’hui, huit kilomètres servent déjà au trafic, mais la route ne sera complète qu’en 2028, si tout va bien. Jusqu’à 1 000 ouvriers ont participé à l’aventure, encadrés par les mastodontes Bouygues et Vinci, épaulés par de nombreuses entreprises locales.
Comment cette opération a-t-elle été financée ? Voici la répartition des principaux contributeurs :
- État français : 420 millions d’euros
- Conseil régional de La Réunion : partie restante
Le schéma financier relève du millefeuille. L’État a débloqué 420 millions d’euros, mais la part du lion incombe au conseil régional. Pour l’outre-mer, jamais autant d’argent public n’avait été engagé sur un tel projet. À la fois démonstration de puissance et source de polémiques, la NRL concentre toutes les contradictions d’une grande œuvre publique.
Quels impacts pour les habitants et l’économie locale ?
Sur l’île, la nouvelle route du littoral a bouleversé la routine. Chaque jour, entre 60 000 et 80 000 véhicules s’y engagent, reliant Saint-Denis à La Possession, longeant la mer sur ce pont de béton. Sécuriser cet axe vital était une priorité : l’ancienne route, régulièrement coupée par des éboulements, faisait craindre le pire. Résultat : les automobilistes respirent mieux, mais doivent composer avec des retards, un trafic encore dense et l’incertitude sur la fin réelle du chantier.
L’environnement, lui, paie un prix fort. La construction des digues a nécessité des quantités colossales de roches. Le projet de carrière à Bois Blanc, à Saint-Leu, a été stoppé net sous la pression du collectif Touch pa nout roche. À court de matériaux, les entreprises ont dû se fournir à Madagascar et à l’île Maurice. Ce ballet de navires a eu un impact tangible sur le récif corallien des Lataniers : le conseil scientifique régional du patrimoine naturel alerte sur une dégradation accélérée, difficilement réversible.
Sur le plan des transports, la NRL a tout balayé : le projet de tram-train, longtemps présenté comme solution alternative, a été enterré. Les transports en commun stagnent à 5 %. Le débat fait rage : fallait-il investir autant dans une route, ou miser sur une mobilité plus durable ? Transporteurs, associations, riverains : chacun défend sa vision, dans une cacophonie qui illustre bien les tiraillements d’un territoire à la croisée des chemins.
Chronologie, controverses et enjeux actuels autour de cette infrastructure
Depuis 2015, la nouvelle route du littoral s’est transformée en feuilleton, avec ses rebondissements et son lot de crises. Dès le lancement, la réalité rattrape les ambitions : retards en cascade, près de 89 recours devant les tribunaux, ralentissant chaque étape. Aux commandes à l’époque, Didier Robert, président du Conseil régional de La Réunion, doit rapidement gérer la contestation, sur le terrain financier comme écologique.
Face à la pression citoyenne et judiciaire, l’option de poursuivre la digue est abandonnée. Cela déclenche une réaction en chaîne : Bouygues et Vinci réclament des indemnités colossales pour les retards et l’abandon de certains segments (900 millions d’euros d’un côté, 675 millions de l’autre). Le parquet national financier se saisit du dossier, signe que la défiance est totale autour de ce chantier devenu le symbole du « trop cher ». L’ouverture partielle, en août 2022 sous l’impulsion d’Huguette Bello, n’éteint pas la polémique : la route fait toujours débat, dans la rue comme dans les couloirs institutionnels.
La cour des comptes met en cause la gestion du projet. Sur le terrain, la nature continue de trinquer : récif corallien abîmé, menaces sur la biodiversité, contestations sans relâche. Recours, expertises, demandes d’indemnisation : la NRL n’en finit pas de diviser. L’achèvement complet de la route reste suspendu, reflet d’un territoire insulaire qui s’interroge sur ses priorités, à l’heure des choix budgétaires et des compromis environnementaux.
Sur la mer, le béton côtoie les récifs fragiles ; sur l’asphalte, les voitures filent entre interrogations et fierté locale. La route la plus chère du monde n’a pas encore livré tous ses secrets, ni éteint tous les débats. L’histoire, elle, roule encore.